Dans un contexte où le débat autour du changement climatique fait rage, l’heure à la transition écologique se veut pressante pour les entreprises, et ce quelle que soit leur taille. Cependant les plus petites disposent-elles de toutes les armes pour la mener à bien ? Quelles démarches doivent-elles entreprendre ? Telles sont les questions auxquelles notre article répond !

Dans cet article
Sur toutes les lèvres depuis la rentrée 2022, la sobriété énergétique est le mot d’ordre du gouvernement qui a annoncé en août dernier “la fin de l’abondance”. Alors que le contexte géopolitique reste complexe et que le réchauffement climatique ne cesse d’être d’actualité avec un niveau record de canicule cet été, la prise de conscience écologique n’aurait pas secoué que la classe politique mais aussi les Français qui sont près de 9 sur 10 à souligner la responsabilité des entreprises. Aussi ces dernières se doivent-elles de montrer l’exemple. Cependant, la transition écologique s’avèrerait plus difficile pour les plus petites d'entre elles.
Ainsi, quelles sont les notions avec lesquelles les PME doivent se familiariser ? Sont-elles au fait des questions de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises ? À quels défis environnementaux doivent-elles faire face ? Quels comportements et étapes doivent-elles suivre pour entamer leur transition écologique et la mener à bien sans nuire à leur activité ?
GetApp se penche sur ces questions et donne des conseils aux petites et moyennes entreprises à travers l’expérience et l’expertise de :

- Géraldine Laforge, responsable marketing & communication de La Brosserie Française (une PME beauvaisienne ayant entrepris à partir de 2012 une démarche de développement durable)
- Isabelle Lefebvre, consultante en développement durable
- Tiphaine Vidal, consultante et formatrice RSE & développement durable
Qu’est-ce que la transition écologique ?
La transition écologique en quelques mots
Inscrite dans une démarche de développement durable, la transition écologique regroupe l’ensemble des évolutions qui visent un nouveau modèle économique et social, répondant aux grands enjeux environnementaux et apportant une solution pérenne aux menaces qu’affronte la planète. Recouvrant tous les secteurs d’activité, la transition écologique tend à repenser nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble grâce un modèle de développement résilient et durable.
Les concepts liés à la transition écologique des entreprises
Développement durable
La transition écologique s’opère en se fondant sur les principes de développement durable dont les trois piliers, intrinsèquement liés, sont l’écologie, l’économie et le social. Ainsi, le concept de développement durable concilie ces trois notions dans le but de répondre aux besoins présents sans compromettre les capacités des générations futures. Pour relever ce défi efficacement, un modèle de développement durable se doit donc d’être socialement équitable, économiquement viable et écologiquement vivable.
Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
Développement durable appliqué aux entreprises, la RSE définit le rôle que joue une organisation dans la société. En adoptant de manière volontaire cette démarche, elle intègre à ses activités commerciales et ses relations avec les parties prenantes des enjeux sociaux et environnementaux.
Les principaux défis de la transition écologique pour les entreprises
Sur le plan écologique, de nombreuses actions peuvent être initiées par les entreprises. Il dépendra de chacune d’entre elles d’analyser les retombées environnementales de son activité et son secteur, et de mettre en place une politique de transition écologique spécifique. Il existe toutefois des défis principaux et interdépendants qui peuvent être relevés par tous les types d’organisations tels que :
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre : l’établissement d’un Bilan Carbone peut aider les entreprises à évaluer leurs émissions de gaz à effet de serre et à étudier des axes d’amélioration.
- Utiliser des énergies renouvelables : il s’agit de réduire le recours aux énergies fossiles et de viser à les remplacer par des énergies renouvelables.
- Pratiquer l’éco-conception : cette démarche intègre des critères de préservation de l’environnement sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit en ayant notamment recours à des matériaux durables.
- Mettre en place une économie circulaire : son objectif est de limiter la consommation de matières premières, d’eau et d’énergies fossiles en intégrant des principes de durabilité, de réutilisation et de recyclage de matériaux.
- Favoriser les circuits courts : un parcours de distribution engageant un nombre très limité d'intermédiaires permet notamment de minimiser son empreinte carbone.
- Améliorer la gestion des déchets : il s’agit de choisir des filières conformes à la réglementation en vigueur, sensibiliser ses employés, supprimer les produits à usage unique ou encore mettre en place une signalétique claire.
- Protéger la biodiversité : pour la protéger, différentes actions permettent d’atténuer au maximum les impacts négatifs des activités humaines comme diminuer la pollution de l’air en repensant sa consommation d’énergie.
Représentant 99,9 % des entreprises en France, les PME ont un rôle majeur à jouer tant pour assurer le futur de la planète que la pérennité de leur activité. Cependant, ont-elles conscience de ces problématiques ? Sont-elles dores et déjà prêtes à débuter une transition écologique ?
Transition écologique, développement durable et RSE : quid des PME ?
Où en sont les PME ?
D’après une étude récente menée par Bpifrance Le Lab, les dirigeants de PME seraient bel et bien sensibilisés aux enjeux de transition écologique sans toutefois appliquer des mesures concrètes dans leur stratégie ni modifier leur modèle d’entreprise.
Tiphaine Vidal, le confirme : “Il y a encore du travail à faire mais la prise de conscience est de plus en plus grande chez les PME, notamment dans le contexte actuel. Il y a beaucoup de volonté d’agir mais le déclic pour passer concrètement à l’action ne s’est pas encore activé.”
Pour les PME interrogées dans le cadre de l’enquête de Bpifrance Le Lab, des freins à leur transition sont avancés et concerneraient principalement le financement et la technologie.
Pour Isabelle Lefebvre, ce sont les idées reçues sur leurs propres capacités qui ralentissent les PME. Selon elle, la plupart ne sont pas conscientes qu’elles adoptent déjà des pratiques de développement durable. Le défi est alors de comprendre les enjeux et de faire en sorte de pousser les démarches entreprises. Elle ajoute : “Les PME sont plus prêtes que les grandes entreprises car elles sont plus agiles. Cette agilité peut leur permettre de s’aligner plus vite. Par ailleurs, les PME peuvent bénéficier de plus d’aides que les grands groupes.”
Quelles sont les aides dont les PME peuvent bénéficier pour engager leur transition écologique ?
Pour les PME s’engageant dans une démarche de transition écologique, des aides et financement publics peuvent leur être proposés comme entre autres :
- Les aides de l’ADEME (Agence de la transition écologique) ;
- Le prêt Eco-Energie (PEE) de Bpifance ;
- Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) ;
Le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des TPE/PME.
Ainsi, la mésinformation inciterait les PME à penser que les politiques de transition écologique, de développement durable et de RSE sont coûteuses et représentent un obstacle à leur développement. Or, pour Géraldine Laforge, Isabelle Lefebvre et Tiphaine Vidal, elles peuvent êtres sources d’opportunités.
Quelles sont les opportunités d’une transition écologique pour les PME ?
Un levier de croissance à long terme
Leurs impacts représenteraient, tout d’abord, un levier de croissance à long terme. C’est ce que confirme Géraldine Laforge : “en menant une démarche de développement durable, fondée entre autres sur la relocalisation de notre production, la formation de nos salariés, la conception de produits écoresponsables et l’optimisation de nos locaux, nous avons constaté un impact positif sur la croissance. Certaines dépenses ont été compensées par de nouvelles méthodes de production, de logistique ou de stockage.”
Tiphaine Vidal ajoute : “Une fois la démarche lancée, les bénéfices suivent. Cela s’explique par les économies sur les consommations d’énergie, les consommables, la gestion des achats, la logistique…”
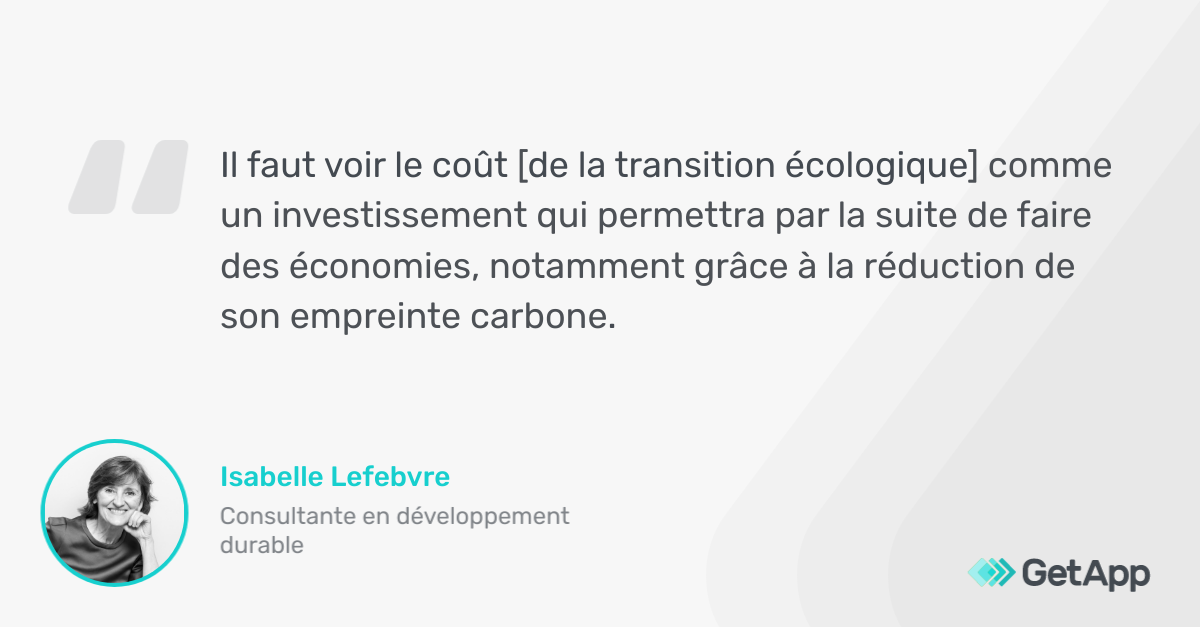
Pour Isabelle Lefebvre, il existe un coût immédiat mais “les bénéfices sont bien supérieurs à celui-ci. Il faut voir ce coût comme un investissement qui permettra par la suite de faire des économies, notamment grâce à la réduction de son empreinte carbone.”
D’autres facteurs peuvent expliquer cette croissance à long terme, selon elle, comme “l’amélioration des processus de l’entreprise qui n’avaient pas été revisités depuis longtemps et qui ont pu être retravaillés.”
Un avantage concurrentiel auprès de clients BtoB
Repenser son business model pour qu’il soit conforme aux exigences environnementales et de développement durable peut non seulement avoir des retombées positives sur les résultats à long terme d’une PME mais aussi l’aider à se démarquer auprès de ses clients BtoB ou du secteur public.
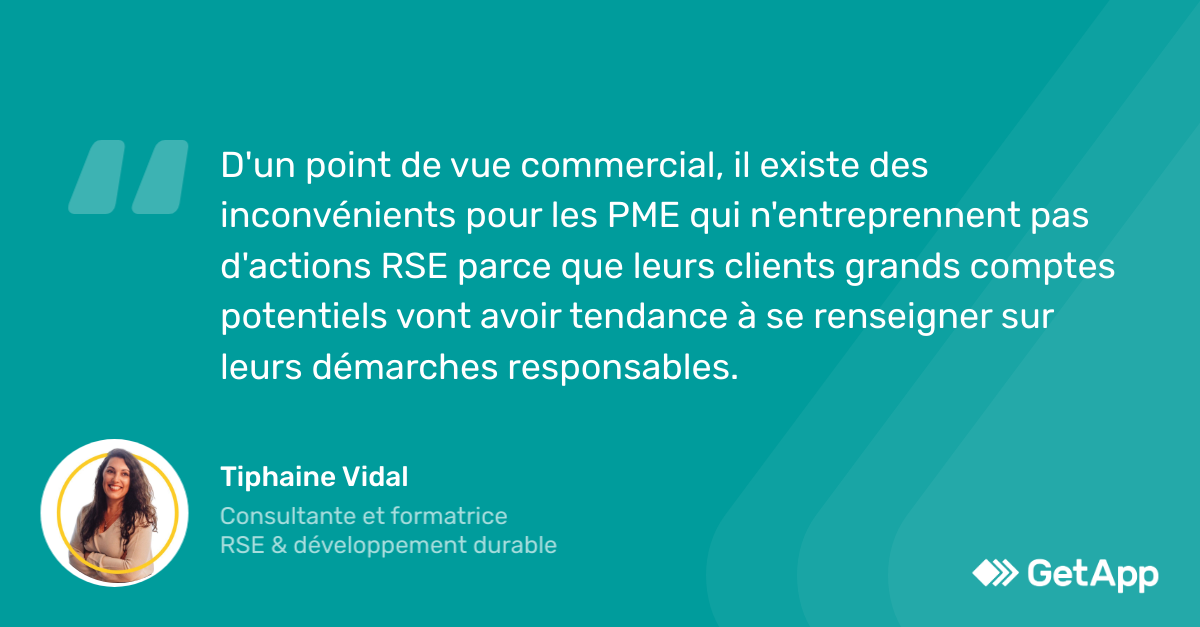
Comme le souligne Tiphaine Vidal : “D’un point de vue commercial, il existe des inconvénients pour les PME qui n’entreprennent pas d’actions RSE parce que leurs clients grands comptes potentiels vont avoir tendance à se renseigner sur leurs démarches responsables. Ainsi, le fournisseur qui sera le plus performant au niveau RSE gardera la relation commerciale. Il existe également une forme de mise en concurrence sur ces sujets dans les appels d'offres publics.”
Une marque employeur et une réputation globale plus fortes
L’une des problématiques que la crise sanitaire a soulevée concerne une quête de sens au travail. Les employés accorderaient ainsi une plus grande importance aux questions de RSE qu’auparavant et les entreprises accuseraient des pénuries de personnel. Pour Tiphaine Vidal, engager une démarche sincère en ce sens permettrait aux PME “de résoudre les problèmes de recrutement auxquels elles font actuellement face en améliorant leur marque employeur et donc leur réputation.”
Des conséquences positives qu’a constaté Géraldine Laforge au sein de la PME La Brosserie Française : “Notre projet écologique a plu et convaincu l’ensemble de nos employés, qu’il s’agisse des salariés de la première heure ou des nouveaux. On se rend compte d’ailleurs que notre projet d’entreprise est plus attractif pour les jeunes.”
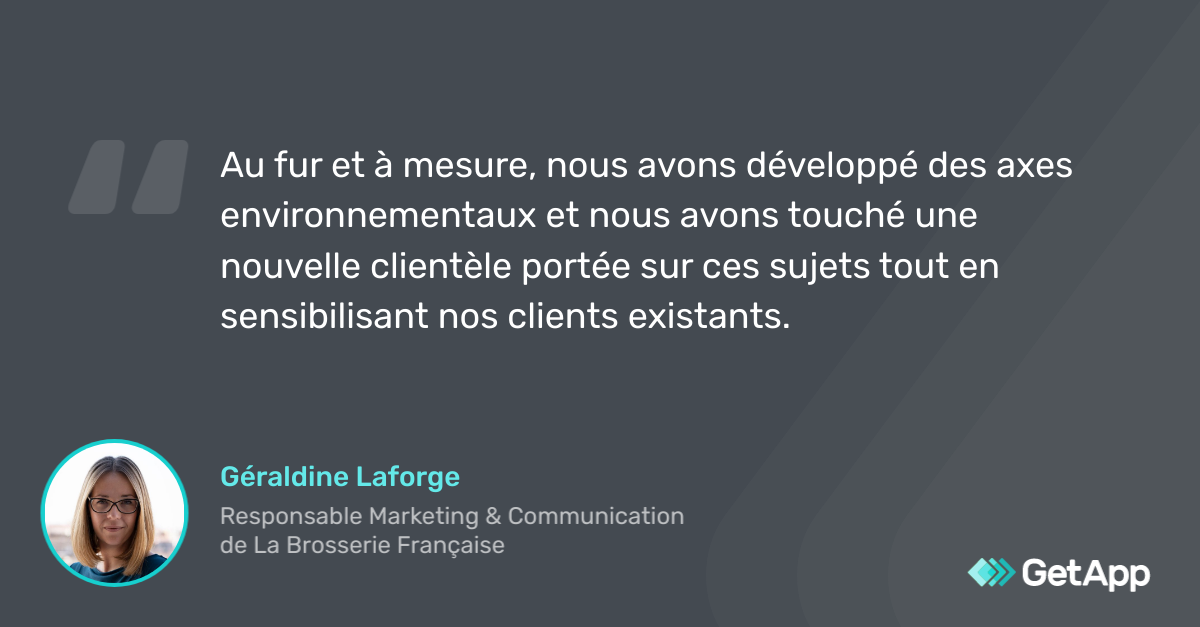
Au-delà de la marque employeur, ces pratiques durables influent sur la réputation globale de l’entreprise et peuvent même influencer les comportements des clients BtoC. C’est ce qu’affirme Géraldine Laforge : “Au fur et à mesure, nous avons développé des axes environnementaux et nous avons touché une nouvelle clientèle portée sur ces sujets tout en sensibilisant nos clients existants.”
De ce fait, la transition écologique, impulsée par un modèle de développement durable, suppose un enjeu de performance globale pour les PME, tant au niveau de la croissance que de l’image interne et externe. Cependant, quels sont les comportements et étapes à suivre pour la mettre en marche sans accroc ?
Entreprendre une démarche de transition écologique : conseils pour les PME
1. Se pencher dès maintenant sur ces questions
L’accélération du réchauffement climatique ainsi que la crise énergétique rendent l’urgence environnementale évidente. Ainsi, pour y répondre efficacement, des mesures concrètes doivent être étudiées dès à présent par l’ensemble des acteurs de la société, les PME incluses. Comme le soulève Isabelle Lefebvre, “la transition écologique est inéluctable pour toutes les entreprises. Plus celles-ci anticipent et réagissent tôt, c’est à dire maintenant, plus elles amortissent le choc.”
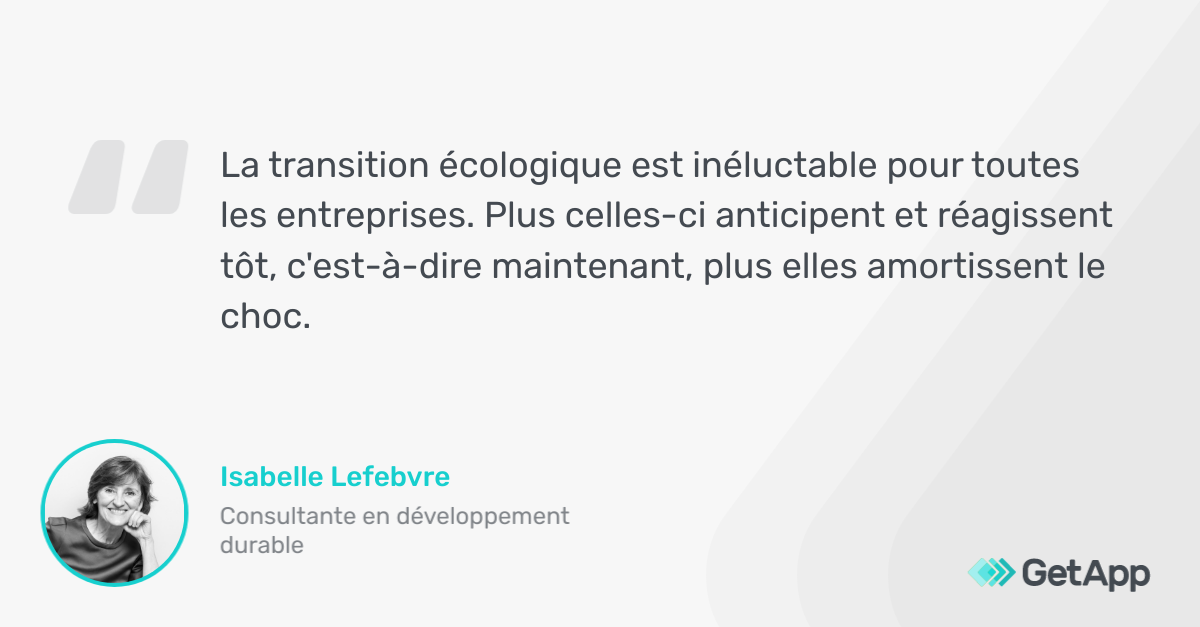
Tiphaine Vidal ajoute : “Par manque de temps ou parce que leurs priorités sont tout autres, les PME mettent souvent de côté la thématique RSE. Alors qu’idéalement, il faudrait avoir dès maintenant un angle RSE pour faire face à l’ensemble des problématiques rencontrées par l’entreprise.”
Pour Géraldine Laforge, les PME ont évidemment un rôle à jouer tant “leurs actions ont des conséquences directes sur le collectif”. Selon elle, l’avantage des petites et grandes entreprises est qu’elles “peuvent réagir vite en raison d’une plus grande capacité d’adaptation”.
2. S’informer et se former
De nombreuses préoccupations peuvent entraver la transition écologique des entreprises comme la peur du changement. Or, d’après Géraldine Laforge, cette appréhension peut être contrée en s’informant. Elle ajoute : “Il ne faut pas hésiter à remettre en question les modèles du passé. L’important est d’avoir un œil neuf.”
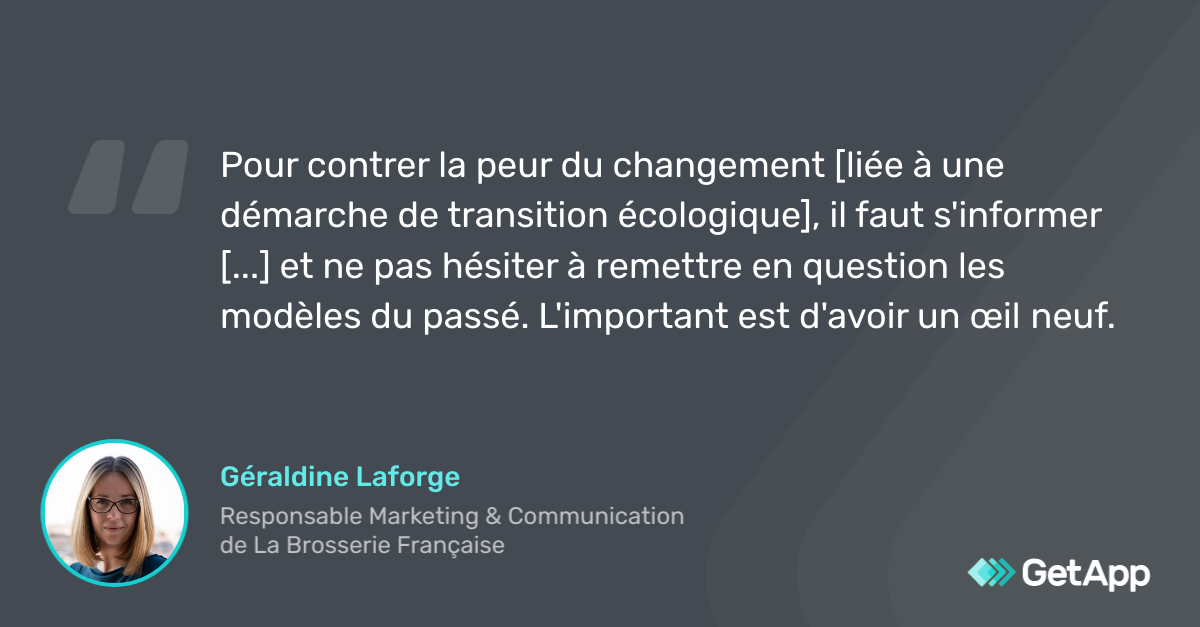
S’informer sur les enjeux environnementaux est également le maître-mot d’Isabelle Lefebvre qui encourage les PME à “être curieuses, s’intéresser, chercher des informations, rentrer en relation avec des interlocuteurs plus armés sur ces questions.”. Elle ajoute : “Sur toutes les thématiques environnementales, certaines entreprises sont plus avancées que d’autres. Il serait donc intéressant pour les PME d’initier une coopération et un codéveloppement.”
Par ailleurs, se faire accompagner par un consultant en développement durable peut être une option envisagée par les PME pour se familiariser avec ces concepts.
3. Impliquer ses équipes
Quand les sujets de RSE et de transition écologique sont abordés par une PME, ils restent souvent entre les mains de la direction, comme le constate Tiphaine Vidal. Or, ces problématiques se doivent d’être portées par l’ensemble des collaborateurs afin de rendre le cheminement plus fluide et engageant.

La consultante explique : “Quand la question de la transition écologique et de la RSE n’est traitée que par le dirigeant ou une seule personne, l’enjeu peut être mal compris et mal partagé avec le reste des équipes. L’idée est d’en faire un projet collectif. C’est un moteur également pour les salariés.”
Il existe différentes manières d’impliquer ses équipes comme mettre en place des ateliers de sensibilisation ou lancer des sondages en ligne au moment de l’étude et de la définition des actions à mener. Ces sessions peuvent favoriser l’émergence d’idées qui aideront à bâtir un plan concret.
Cette démarche collective s’avère primordiale même quand l’entreprise décide de faire appel à un consultant RSE pour l’accompagner dans sa transition. Isabelle Lefebvre ajoute : “Le rôle du consultant RSE n’est pas de tout faire tout seul mais d’animer et piloter des projets avec la contribution de tout le monde. Le faire collectivement permet d’aller beaucoup plus vite et d’être plus efficace.” Tiphaine Vidal conseille ainsi d’ ”identifier des ambassadeurs RSE en interne pour porter le projet à travers des points réguliers.”
4. Étudier en profondeur les axes d'amélioration
Une fois les démarches de sensibilisation établies vient la définition des axes d’amélioration. Ces derniers ne seront pas les mêmes pour toutes les PME. Ainsi, chacune d’entre elles devra les définir en fonction de sa situation personnelle.
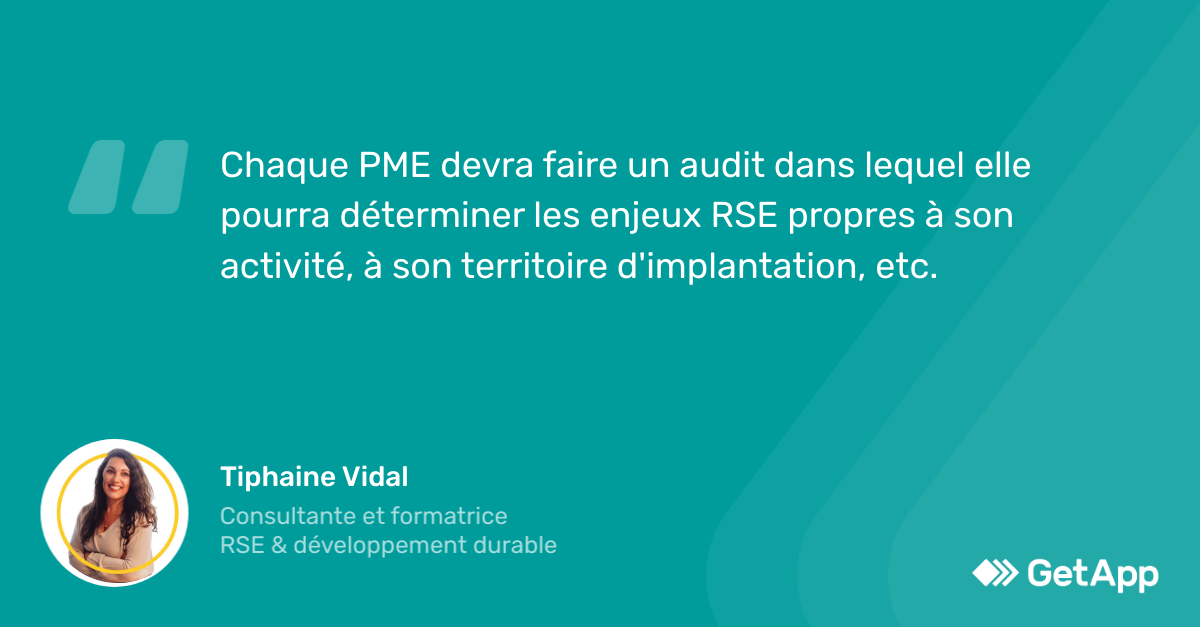
Comme l’affirme Tiphaine Vidal : “Chaque PME devra faire un audit dans lequel elle pourra déterminer les enjeux RSE propres à son activité, à son territoire d’implantation, à la taille de son organisation, etc.”
Isabelle Lefebvre recommande ainsi de se pencher sur “sa chaîne de valeurs en amont et en aval en répertoriant les matières premières utilisées ou en analysant le cycle de vie des produits.” Elle ajoute : “Il s’agit de se poser les bonnes questions, de réunir les parties prenantes de l’entreprise autour d’une table pour étudier l’activité de l’entreprise et détecter là où elle a un impact sur l’environnement ou la société. Cela est important pour savoir où l’entreprise doit agir.”
Cette introspection permettra ainsi aux entreprises de non seulement se rendre compte des actions qu’elles ont déjà entreprises sans en être véritablement conscientes mais aussi d’identifier les enjeux clés à aborder et les stratégies à revoir.
5. Planifier soigneusement les actions à mener
Étudier en profondeur sa situation et ses axes d’amélioration sert à déterminer l’ensemble des actions à mener. Cependant, pour qu’elles aboutissent et aient un impact positif significatif, il est nécessaire de les prioriser.
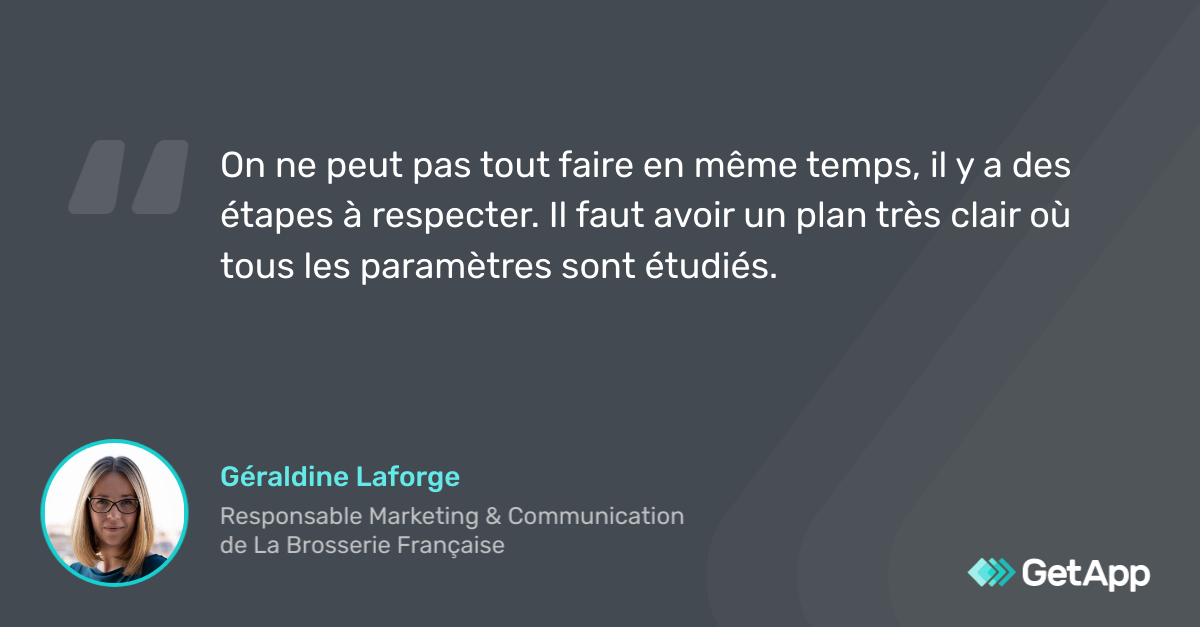
Comme l’explique Géraldine Laforge : “On ne peut pas tout faire en même temps, il y a des étapes à respecter. Il faut avoir un plan très clair, où tous les paramètres sont étudiés. En ce qui concerne notre entreprise, pour maintenir la viabilité de notre projet, nous avons dû mettre en place une gestion ultra précise des ressources et nous fonder sur un modèle réfléchi où l’anticipation est de mise. “
Tiphaine Vidal met également en garde les PME qui veulent aller trop vite et lancer plusieurs actions à la fois sans avoir réellement pris le temps de construire une démarche solide : “Le risque en agissant ainsi est de faire du saupoudrage d’actions pour se donner bonne conscience assez rapidement mais cela ne sera pas efficace dans la durée. Il faut prendre le temps de construire un vrai projet reflétant une stratégie et une vision à long terme.”
Isabelle Lefebvre renchérit : “Les différentes démarches collectives permettront de rédiger un plan d’action où devront figurer les priorités, les rôles de chacun, les délais de chaque mesure ou étape, les indicateurs d’évaluation, les ressources nécessaires, etc.”
Un plan d’actions pensé dans les moindres détails se doit donc d’être élaboré. D’après Tiphaine Vidal, pour qu’il soit pertinent, il devra “réconcilier des axes écologiques, sociaux et économiques sans être dans un objectif purement financier ou démagogique.”
6. Faire preuve de sincérité et de transparence
Mener une transition écologique et mettre en place une politique RSE au sein de sa PME doivent ainsi s’accompagner de mesures consistantes reflétant de vraies valeurs défendues par l’organisation. En effet, si avoir une démarche écoresponsable peut s’avérer payante en matière d’image, son impact positif possible sur la réputation de l’entreprise ne doit en aucun cas être le seul moteur pour engager sa transition.
Pour Géraldine Laforge : “les PME qui se lancent dans la transition écologique ne doivent pas le faire par démagogie mais par conviction. Au-delà de l’image, il faut suivre avec des actions concrètes en privilégiant la transparence.”

La transparence est également prônée par Isabelle Lefebvre, notamment pour que la démarche ne soit pas interprétée comme du greenwashing : “Il est essentiel d’être toujours transparent sur son processus de production. Aujourd’hui, aucune entreprise n’est à 100 % écologique. Ce qui est important, c’est la dynamique et l’intention. Il est alors nécessaire de montrer sa bonne volonté et les éléments tangibles qui prouvent ses actions.”
Qu’est-ce que le greenwashing ?
Le greenwashing (ou écoblanchiment) désigne des pratiques marketing, utilisées par certaines organisations, qui abusent d’arguments trompeurs pour mettre en avant un supposé engagement écologique.
De plus, la communication de sa démarche sur les réseaux sociaux ne doit pas être une priorité. Elle peut même s’avérer contre-productive. Géraldine Laforge explique : “Une démarche de développement durable est complexe et ne peut être résumée en quelques mots. Sur les réseaux sociaux, les discours écologiques peuvent être utilisés à tort et à travers, il s’avère alors difficile pour ceux qui ont une une approche bien plus poussée de se faire entendre ou de se distinguer du greenwashing.”
Isabelle Lefebvre ajoute : “Il faut avant tout privilégier la communication auprès des parties prenantes, soit les investisseurs, les salariés, les candidats, les banques, les clients, les fournisseurs…”
La transition écologique des PME : une dynamique vertueuse
Réduction des coûts, marque employeur plus forte, augmentation de son attractivité auprès des consommateurs, des clients BtoB et du secteur public…. En plus de leur permettre de minimiser leurs impacts environnementaux, la transition écologique représente de nombreuses opportunités de développement pour les PME si tant est qu’elles réussissent à mettre en place un plan d’action concret et viable après s’être informées et formées aux pratiques de développement durable et avoir soigneusement analysé les axes d’amélioration propres à leur activité en impliquant l’ensemble des parties prenantes.
